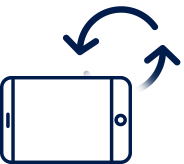Harcèlement moral au travail : cadre juridique et obligations de l’employeur
17 octobre 2025Le harcèlement moral au travail n’est plus une notion abstraite. Il s’invite désormais dans l’actualité, les tribunaux et les conversations quotidiennes.
Pour les employeurs, c’est à la fois un risque juridique majeur et un enjeu humain essentiel, qui impose une vigilance constante.
Dans un contexte où la parole se libère et où la jurisprudence se montre exigeante, comprendre ce qu’est — et ce que n’est pas — le harcèlement moral est indispensable. C’est un levier de prévention managériale et un signal fort de responsabilité sociale.
Définir précisément le harcèlement moral… et éviter les confusions
Le Code du travail (article L.1152-1) définit le harcèlement moral selon trois critères cumulatifs :
- Des agissements répétés : un acte isolé, même choquant, ne suffit pas juridiquement
- Un objet ou un effet : ces agissements doivent viser ou avoir pour conséquence de dégrader les conditions de travail
- Une atteinte caractérisée : à la dignité, aux droits, à la santé physique ou mentale, ou à l’avenir professionnel du salarié
Il convient de distinguer clairement le harcèlement moral de :
- l’exercice normal du pouvoir de direction (remarques, évaluations, sanctions proportionnées)
- une faute managériale ponctuelle
- un conflit professionnel, si les actes ne présentent pas de répétition ni d’atteinte grave
La jurisprudence rappelle que dès lors qu’un salarié fournit des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il revient à l’employeur de démontrer que les faits invoqués ne constituent pas un harcèlement ou qu’ils reposent sur une justification objective (Cass. soc., 6 octobre 2004).
La Cour a également précisé qu’un employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il agit immédiatement dès la connaissance de faits suspects et met en œuvre toutes les mesures propres à les faire cesser (Cass. soc., 1ᵉʳ juin 2016).
Autrement dit : la réactivité est une clé juridique autant qu’un signe de management responsable.
L’obligation de sécurité : un devoir de moyens renforcé
L’article L.4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de garantir la santé physique et mentale des salariés.
Cette obligation, longtemps considérée comme une obligation de résultat, est aujourd’hui reconnue comme une obligation de moyens renforcée : l’entreprise doit démontrer avoir pris toutes les mesures de prévention, d’information et d’action nécessaires.
- Quand la prévention fait défaut
Dans une décision du 27 novembre 2019, la Cour de cassation a condamné un employeur pour n’avoir rien fait après le signalement d’un risque de harcèlement.
Même en l’absence de preuve définitive, l’inaction suffit à engager la responsabilité. L’employeur ne peut invoquer sa bonne foi s’il reste passif face à une alerte.
- Quand la réaction est jugée proportionnée
Plus récemment, la Cour a admis que l’employeur n’est pas tenu de lancer systématiquement une enquête interne dès la moindre plainte, à condition de prendre des mesures adaptées et documentées pour protéger la santé du salarié (Cass. soc., 12 juin 2024).
L’essentiel : agir de manière proportionnée et traçable. En cas de tensions avérées entre collaborateurs, la médiation professionnelle peut constituer une réponse adaptée pour rétablir le dialogue.
Responsabilité et exonération : une voie étroite mais possible
Pour écarter sa responsabilité, l’employeur doit pouvoir démontrer, preuves à l’appui, qu’il a agi de manière exemplaire à chaque étape :
- Avoir mis en place des mesures de prévention : politiques internes claires, formations, sensibilisation des managers, canaux d’alerte connus des salariés.
- Avoir réagi sans délai dès la connaissance de faits suspects : entretiens, enquête interne, mesures conservatoires ou réorganisation temporaire.
- Avoir objectivement vérifié et traité les faits signalés, en montrant que les décisions prises (évaluations, sanctions, changements de poste, etc.) reposaient sur des motifs légitimes et documentés, sans lien avec une intention de nuire ou une atteinte à la dignité.
En résumé, l’employeur doit pouvoir prouver à la fois sa prévention en amont, sa réactivité en cas d’alerte, et la légitimité de ses décisions.
La Cour de cassation a précisé, notamment dans l’arrêt Air France (25 novembre 2015), que seule une combinaison cohérente de prévention, réaction et justification peut permettre une exonération.
Les juges attendent des éléments tangibles : comptes rendus, mails, entretiens, documents internes.
En l’absence de preuve écrite, la responsabilité reste engagée.
Harcèlement moral institutionnel : le risque systémique
La jurisprudence la plus récente reconnaît désormais la possibilité d’un harcèlement moral institutionnel :
c’est-à-dire lorsque les méthodes de management ou la stratégie d’entreprise créent une souffrance collective (pression constante, objectifs inatteignables, isolement structurel).
Dans l’affaire France Télécom / Orange (Cass. crim., 21 janvier 2025), la Cour a confirmé que la politique managériale elle-même pouvait constituer du harcèlement moral, engageant la responsabilité pénale de l’entreprise et de ses dirigeants.
Ce tournant rappelle que la prévention ne se limite pas aux comportements individuels, mais concerne aussi les modes d’organisation et de pilotage.
Bonnes pratiques et vigilance opérationnelle
Quelques repères pour les employeurs et les managers :
| Objectif | Actions attendues | Ce que les juges (et les salariés) examinent |
|---|---|---|
| Prévenir | Former les managers, clarifier les règles internes, ouvrir des canaux d’alerte | Traçabilité des actions, charte, règlement intérieur |
| Détecter | Identifier les signaux faibles : absences, tensions, isolement | Suivi RH, entretiens réguliers |
| Réagir | Organiser un entretien, proposer des mesures provisoires, lancer une enquête si besoin | Dates, preuves de suivi, échanges documentés |
| Justifier | Montrer que la réponse était proportionnée et objective | Comptes rendus, analyses factuelles |
| Suivre | Évaluer les effets, ajuster les mesures | Bilan, témoignages, indicateurs RH |
Dès qu’un signal d’alerte apparaît (plaintes, malaises, départs répétés), l’entreprise doit agir et documenter chacune de ses démarches.
Une simple réunion de suivi ou une trace écrite peut, à elle seule, prouver la bonne foi et éviter une condamnation.
-> Voir notre article : Comment détecter la détresse psychologique ?
Agir avant le contentieux : transformer la contrainte en levier
Le cadre juridique du harcèlement moral n’a pas pour but d’entraver la gestion managériale, mais d’en renforcer la qualité.
Pour l’employeur, il s’agit moins de « se couvrir » que de structurer une culture de prévention et de dialogue.
Anticiper, écouter et documenter : ces trois réflexes permettent de passer d’une logique de risque à une logique de confiance et de responsabilité partagée.
Chez ADH Conseil & Recrutement, nous accompagnons les dirigeants et les DRH dans la mise en place de pratiques de management préventives, éthiques et sécurisées, notamment via le coaching professionnel, le 360 feedback.
En résumé
- Le harcèlement moral repose sur des critères précis : répétition, intention ou effet, atteinte.
- L’employeur a une obligation de moyens renforcée en matière de prévention.
- La réactivité et la traçabilité sont les meilleures protections.
- La prévention dépasse les comportements individuels : elle touche à la culture managériale.